Voter pour Harris ou Trump, c’est voter pour Israël. Voter contre le dollar, c’est voter contre Israël, contre les guerres sans fin et contre l’hégémonie toxique qui empoisonne le monde.
Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?
— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025
Jesse Watters: “The media said that Musk was the co-president… The media said Trump was doing favors for Elon Musk. Well, if you look at this big, beautiful bill, there’s no favors for Elon Musk in it at all”
— Defiant L’s (@DefiantLs) June 5, 2025
pic.twitter.com/9Py3TM5Zkl

Le pétrodollar est un instrument du MAL. La capacité de l’empire américain à continuer d’imprimer des dollars lui permet de continuer à perpétrer le mal partout sur la planète.
Israël brûle vifs des patients d’hôpitaux tandis que les bénéficiaires corrompus de pots-de-vin juifs célèbrent un criminel de guerre. Il est temps que toutes les nations victimes s’unissent et laissent l’empire en faillite se noyer dans ses dettes. Sanctionnez les malfaiteurs en cessant d’utiliser le dollar.
Introduction
Release the files. https://t.co/dvGYjLstnT pic.twitter.com/7fc6DC0xBq
— WikiLeaks (@wikileaks) June 5, 2025
We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. Don't fight, guys😱!
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 6, 2025
Les élections américaines de 2024 se profilent à l’horizon, mettant en lumière une dichotomie électorale marquée entre deux figures emblématiques : Joe Biden et Donald Trump. Bien que ces candidats incarnent des visions distinctes de la politique intérieure, leur impact transcende les frontières américaines, touchant des enjeux internationaux cruciaux. La dynamique entre les États-Unis et Israël, ainsi que l’hégémonie mondiale des américains, jouent un rôle déterminant dans la redéfinition des priorités politiques et diplomatiques des États-Unis.
Joe Biden, le président actuel, représente une continuité de l’approche traditionnelle des États-Unis envers le Moyen-Orient, en mettant l’accent sur le soutien à Israël. Son administration a maintenu des relations étroites avec le pays, même face à des tensions croissantes dans la région. D’un autre côté, Donald Trump, ancien président, a également adopté une position pro-israélienne mais avec un style et des méthodes controversés. Sa politique, marquée par le mouvement d’une partie de l’ambassade américaine à Jérusalem, a provoqué des débats intenses sur l’avenir des négociations de paix au Moyen-Orient.
Le choix entre Harris et Trump ne doit donc pas être perçu uniquement à travers le prisme des politiques domestiques. Au contraire, il s’agit également d’un choix qui pourrait influencer significativement les alliances internationales et la perception des États-Unis sur la scène mondiale. Les intérêts israéliens, souvent perçus comme un baromètre de la politique extérieure des USA, sont au cœur de cette dichotomie électorale, nous poussant à examiner comment ces préférences se traduiront dans la formulation des politiques futures. Ainsi, ces élections ne représentent pas simplement une course pour le pouvoir ; elles dictent également quel visage l’Amérique affichera sur la scène mondiale, influençant les relations avec de nombreux pays.
L’influence d’Israël sur la politique américaine
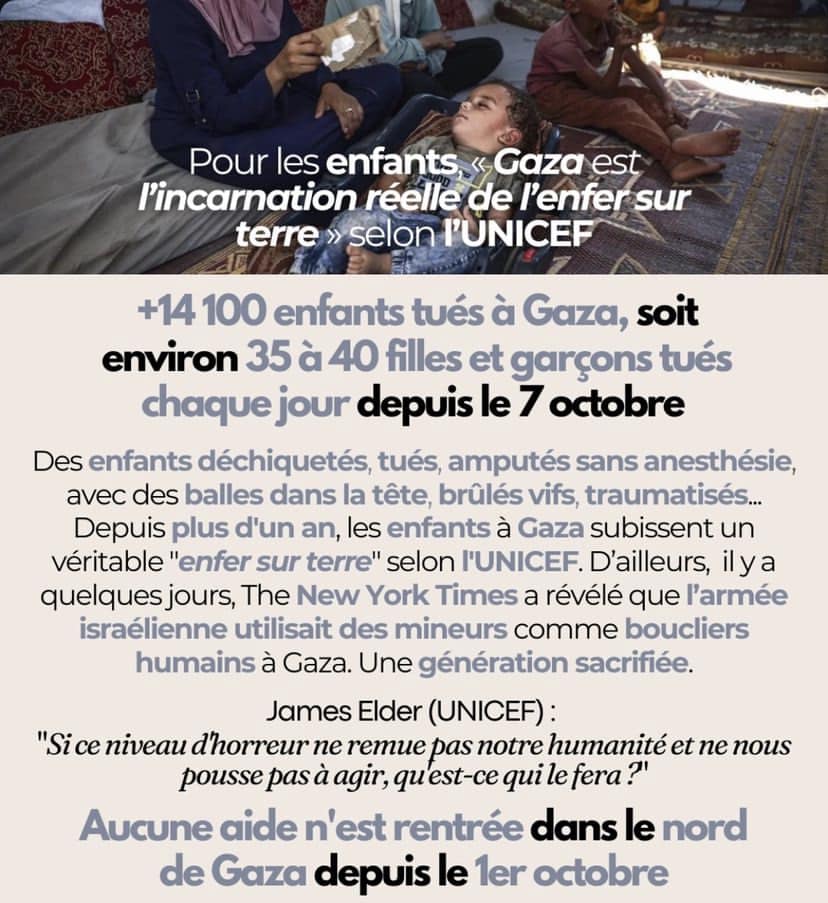
Les relations entre les États-Unis et Israël remontent à la création de l’État d’Israël en 1948. Depuis lors, cette alliance stratégique a largement façonné la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Les administrations américaines successives, qu’elles soient républicaines ou démocrates, ont invariably manifesté un soutien inconditionnel à Israël, considéré comme un allié clé dans cette région complexe. Ce soutien se traduit non seulement par des aides financières substantielles, mais aussi par des actions diplomatiques favorisant les intérêts israéliens sur la scène internationale.
La puissance des lobbyistes pro-israéliens, tels que l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), a indubitablement renforcé cette influence. En mobilisant des ressources considérables et en exerçant une pression sur les politiciens, ces groupes ont créé un climat parmi les élus qui rend difficile toute critique de la politique israélienne. Ainsi, les candidats, lors des élections présidentielles et autres scrutins, ressentent souvent la nécessité d’afficher leur soutien à Israël pour maintenir leur réputation et leur chance de succès. Cela se traduit par une compétition, tant au niveau des infrastructures électorales que des discours politiques, pour montrer un alignement avec les ambitions israéliennes.
Historiquement, ce soutien a été narré comme une obligation morale, motivée par des valeurs communes telles que la démocratie et les droits de l’homme. Toutefois, il n’est pas rare que cette dynamique soit également perçue comme une question d’hégémonie et de pouvoir, traditionnellement en faveur des intérêts stratégiques américains. En conséquence, l’influence d’Israël sur la politique américaine ne se limite pas à un simple alignement moral, mais s’enracine également dans des considérations géopolitiques plus larges qui impactent les choix électoraux américains.
Les ramifications de voter pour Biden ou Trump
Le choix entre voter pour Joe Biden avec Kamala Harris ou pour Donald Trump est loin d’être une décision anodine, surtout dans le contexte des relations internationales et des dynamiques de pouvoir globales. Un aspect central de cette décision concerne les implications sur la politique étrangère américaine, en particulier en ce qui concerne la relation avec Israël. Les partisans de Biden envisagent généralement un renforcement des liens avec l’État israélien, en se concentrant sur des politiques qui soutiennent la sécurité d’Israël tout en plaçant une importance sur la diplomatie. En revanche, le programme de Trump a souvent été perçu comme plus nuancé, mettant en avant un soutien fort à Israël mais avec des approches parfois transactionnelles.
Les ramifications d’un vote en faveur de l’un ou l’autre candidat peuvent également se ressentir sur les conflits en cours au Moyen-Orient. Dans le cadre d’une administration Biden, le retour à l’accord sur le nucléaire iranien pourrait être envisageable, avec des efforts pour rétablir des dialogues qui pourraient influencer la paix régionale. Cela pourrait potentiellement atténuer certaines tensions avec des groupes qui s’opposent à Israël. En revanche, Trump a opté pour une posture plus dure, susceptible de renforcer les tensions tout en solidifiant des alliances comme celles établies avec les Émirats arabes unis et Bahreïn.
En outre, le résultat des élections incarne un choix plus large: celui de la mise en avant de l’hégémonie américaine sur la scène mondiale versus un retour à des relations plus traditionnelles. Une victoire de Biden pourrait conduire à une réévaluation des compromis stratégiques, favorisant une approche multilatérale. Inversement, un vote en faveur de Trump risquerait de renforcer une politique unilatérale, accentuant la position d’Israël comme allié clé des États-Unis dans une ambiance concurrentielle de l’ordre mondial.
Le dollar comme symbole de pouvoir
Le dollar américain, souvent considéré comme la monnaie de réserve mondiale, joue un rôle crucial dans la dynamique économique et politique globale. Sa prévalence dépasse les simples transactions financières, agissant comme une pierre angulaire dans le commerce international. En effet, plus de 60 % des réserves de change mondiales sont détenues en dollars, ce qui reflète sa domination et l’influence des États-Unis sur les marchés financiers internationaux.
L’hégémonie du dollar ne se limite pas à son utilisation dans les échanges commerciaux. Elle s’étend également aux implications géopolitiques, alignant la puissance économique des États-Unis avec ses ambitions stratégiques. Les dépenses militaires américaines, par exemple, sont souvent financées par le recours à cette monnaie, renforçant ainsi son statut et son pouvoir sur la scène mondiale. Cela attire l’attention des électeurs, en particulier ceux qui s’interrogent sur les choix qu’ils devront faire ces prochaines élections, notamment entre Harris et Trump.
Pour les électeurs, choisir un candidat peut être un reflet de leurs préoccupations sur le dollar en tant que symbole de pouvoir. Les politiques économiques proposées par chaque candidat peuvent avoir des répercussions directes sur la position du dollar dans l’économie mondiale. Par exemple, une approche plus protectionniste pourrait altérer la perception du dollar, tandis qu’une politique favorisant les relations commerciales internationales pourrait renforcer sa position. Dans ce contexte, il est essentiel que les électeurs prennent en considération non seulement les implications économiques, mais également les enjeux plus larges de souveraineté et de sécurité nationale liés à l’hégémonie du dollar américain.
Voter contre le dollar : un acte de résistance
Le choix de voter contre le dollar peut s’interpréter comme une forme de résistance face à l’hégémonie américaine, notamment dans le contexte des conflits internationaux, dont ceux impliquant Israël. Dans un monde où le dollar est perçu comme une clé de voûte de l’influence économique des États-Unis, ce vote peut symboliser une réinflexion sur les valeurs que cette domination impose. En effet, le dollar américain joue un rôle central dans le financement des opérations militaires et dans l’entretien des alliances stratégiques, contribuant ainsi au soutien d’Israël dans ses diverses controverses géopolitiques.
De plus, l’opposition au dollar, par ce choix électoral, renvoie à une quête d’autonomie économique et politique. En remettant en question la monnaie dominante, l’électorat exprime une volonté de diversifier les sources de financement et de création de alliances qui ne sont pas subordonnées aux intérêts américains. Dans cette optique, voter contre le dollar devient un acte symbolique de défi envers une structure de pouvoir souvent perçue comme oppressive. Ce choix pose aussi des interrogations sur l’avenir des relations internationales et la possibilité d’émergence de nouvelles puissances financières qui pourraient remodeler l’ordre mondial actuel.
Par conséquent, voter contre le dollar ne se limite pas simplement à un acte de défi financier. Il incarne un mouvement plus large visant à questionner les fondements mêmes de l’hégémonie globale américaine. Cela soulève des débats sur la manière dont les interactions économiques influencent les conflits géopolitiques, tels que ceux liés à Israël. En conclusion, cette décision électorale peut-est considérée comme un moyen de redéfinir les priorités et les relations dans un paysage international en constante évolution.
Les guerres sans fin et leur lien avec les choix électoraux
Netanyahu est ici en Amérique. S’adressant au Congrès financé par l’AIPAC. Près de 94 pour cent sont financés par l’AIPAC. Le député Thomas Massie n’est pas présent. N’oublions pas des politiciens comme Thomas Massie qui ont révélé des informations si sensibles sur le Congrès, révélant que les gestionnaires de l’AIPAC influençaient les décisions politiques. Ceci est délibérément ignoré en ce qui concerne la mort subite de sa femme, suggérant une possible tentative de le faire taire. La nature corrompue de notre système politique indique que quelqu’un a peut-être utilisé la mort de sa femme comme un avertissement pour le faire taire.
Trump dit : « Je ne suis pas chrétien » Il sera le premier président ouvertement non chrétien. Ne faites pas face, il a secoué la tête quand il a dit « non » et il a dit « vous », les chrétiens, pas « nous ». Je pense que sa fille et Jared Kushner l’ont fait se convertir.
Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont été impliqués dans une série de conflits militaires qui semblent souvent justifiés par des intérêts stratégiques liés à la sécurité d’Israël. Qu’il s’agisse des interventions en Irak, en Afghanistan ou, plus récemment, de l’escalade des tensions en Syrie, il est crucial de reconnaître comment ces guerres ont façonné le paysage politique américain et influencé les choix électoraux des citoyens. Ces engagements militaires sont souvent présentés sous l’angle de la lutte contre le terrorisme ou de la promotion de la démocratie, mais une analyse plus approfondie révèle que les motivations sous-jacentes peuvent inclure le soutien à un allié clé comme Israël.
Les candidates pour des postes électifs, comme Kamala Harris et Donald Trump, sont souvent appelés à prendre position sur des questions liées à ces guerres. Les électeurs, de leur côté, peuvent voter en fonction de leur perception de la politique étrangère américaine – en particulier, sur la manière dont elle influence la relation avec Israël. Dans ce contexte, le soutien à des incursions militaires ou à des interventions au Moyen-Orient peut être vu comme un moyen de maintenir l’hégémonie globale des États-Unis et de renforcer les alliances stratégiques, essentiellement avec Israël.
Le choix électoral peut également servir de référence pour exprimer une opposition à des conflits prolongés. Par exemple, certaines factions au sein du parti démocrate ont plaidé pour une approche plus diplomatique et moins interventionniste dans les affaires du Moyen-Orient, ce qui pourrait modifier les relations traditionnelles avec Israël et encourager des solutions pacifiques. Les choix des électeurs – qu’ils portent sur un candidat ou un autre – ont un impact direct sur la direction que prendra la politique étrangère des États-Unis. Cette dynamique souligne l’importance d’être conscient des implications de nos votes sur la scène internationale et la manière dont ils sont souvent intricissés avec des enjeux militaires et géopolitiques complexes.
L’hégémonie toxique et ses conséquences globales
L’hégémonie toxique se réfère à l’influence exercée par un pays, en l’occurrence les États-Unis, qui engendre non seulement des déséquilibres de pouvoir, mais également des souffrances à l’échelle mondiale. Cette forme d’hégémonie est souvent marquée par des alliances stratégiques, où les intérêts nationaux priment sur le bien-être collectif. Un exemple frappant de ce phénomène réside dans la relation entre les États-Unis et Israël. Ces deux nations partagent des intérêts stratégiques, mais leur collaboration peut se traduire par des politiques qui exacerbent les tensions au Moyen-Orient, affectant inéluctablement la stabilité régionale.
La politique étrangère américaine, avec son soutien indéfectible à Israël, a également un impact sur les perceptions de la démocratie et des droits humains dans d’autres pays. En soutenant un État qui est souvent perçu comme opérant en dehors des lois internationales, les États-Unis minent leur propre crédibilité en tant que champion de la démocratie. Ce double standard contribue à créer un ressentiment profond à l’égard de l’hégémonie américaine et peut mener à des conflits prolongés, à des déplacements de populations, et à la radicalisation de groupes qui se sentent marginalisés.
Les conséquences de cette hégémonie toxique s’étendent bien au-delà des frontières américaines. Dans des contextes où des solutions diplomatiques seraient préférables, la politique interventionniste des États-Unis tend à exacerber les conflits plutôt que de les résoudre. Les alliances construites sur des intérêts personnels peuvent également encourager d’autres nations à adopter des politiques similaires, cultivant par conséquent un environnement global hostile. Cette dynamique ne fait que préfigurer des crises futures, alimentées par des rivalités et des frustrations croissantes face à un ordre mondial perçu comme injuste.
Le rôle des électeurs dans ce paysage
Les électeurs jouent un rôle déterminant dans la façon dont les politiques, tant intérieures qu’extérieures, sont façonnées dans un contexte où des enjeux globaux, comme l’hégémonie américaine et les relations avec Israël, prennent de l’ampleur. Les choix électoraux impactent non seulement les orientations politiques nationales mais aussi la manière dont un pays aborde des questions stratégiques telles que la sécurité nationale et la diplomatie internationale. Chaque scrutin représente ainsi une occasion pour les citoyens d’exprimer leur opinion sur des sujets cruciaux qu’ils jugent prioritaires.
Dans le cadre des élections présidentielles, les électeurs doivent prendre en compte les positions des candidats sur des questions de politique étrangère, y compris leur approche envers Israël. Les choix faits lors de l’élection peuvent avoir des répercussions sur le soutien des États-Unis à des initiatives israéliennes et sur les efforts pour résoudre des conflits au Moyen-Orient. En ce sens, le vote devient un acte responsable où chaque citoyen doit peser les implications de ses décisions pour l’avenir du pays sur la scène internationale.
Il en va de même pour les enjeux domestiques. Les préférences des électeurs peuvent influencer des politiques telles que l’immigration, les droits civiques et même la gestion économique. Les candidats doivent répondre à ces préoccupations tout en naviguant dans un paysage complexe où les intérêts internationaux coexistent avec des besoins locaux. Ainsi, les électeurs ont la responsabilité de s’informer et d’évaluer comment leurs choix peuvent non seulement affecter leur vie quotidienne, mais aussi déterminer la direction globale que prendra leur pays. La moralité du vote ne se limite pas uniquement à la question de qui gagnera ou perdra, mais elle s’étend jusqu’à la façon dont ces choix présenteront un avenir durable pour tous.
Conclusion : Vers un avenir électoral conscient
Dans le contexte électoral actuel, le choix entre Harris et Trump n’est pas simplement une question de préférence personnelle, mais également une décision qui résonne avec des enjeux globaux, tels que la politique israélienne et l’hégémonie mondiale. Les électeurs doivent prendre en considération non seulement les promesses électorales des candidats, mais aussi la manière dont leurs choix peuvent influencer les relations internationales et la stabilité régionale. La politique étrangère des États-Unis, notamment envers Israël, est un facteur déterminant qui pourrait influencer le cours des choix électoraux des citoyens.
Les implications de chaque candidat vont bien au-delà des frontières américaines. Il est essentiel pour les électeurs d’adopter une approche critique concernant les politiques proposées. Par exemple, les répercussions des actions de l’un ou l’autre candidat sur les enjeux de paix et de sécurité au Moyen-Orient doivent être examinées de près. Une simple adhésion à un parti ou un candidat sans une analyse approfondie peut être néfaste non seulement pour la nation, mais aussi pour la communauté internationale.
Évaluer les candidatures avec un esprit critique nécessite de peser les antécédents des candidats en matière de diplomatie, ainsi que leurs visions pour l’avenir. L’électorat a la responsabilité d’exiger davantage de transparence et d’engagement de la part de ses dirigeants. En réfléchissant de manière critique sur leurs choix, les électeurs peuvent contribuer à créer une culture politique plus informée et consciente.
Finalement, le futur électoral est entre les mains des citoyens. En s’engageant activement dans le processus électoral, chaque vote non seulement constitue une voix, mais incarne également les aspirations et les valeurs d’une nation en constante évolution.
https://twitter.com/MyLordBebo/status/1847950677026250777




![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)
![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)

