Ces fonctionnaires américains qui démissionnent au compte-gouttes à cause de la guerre à Gaza
Stacy Gilbert, une des principales responsables du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM) relevant du Département d’Etat américain, a annoncé, mercredi, qu’elle démissionnait de son poste en raison de lapolitique de l’administration du Président Joe Biden à l’égard de la Bande de Gaza.
Le Washington Post a rapporté que Gilbert avait envoyé un courriel aux employés du Département d’État, affirmant que le rapport du département selon lequel Israël n’entravait pas l’arrivée de l’aide à la Bande de Gaza était « incorrecte ».
Le quotidien américain rapporte également que Gilbert s’est abstenu de tout commentaire concernant son courriel. Le journal cite également un fonctionnaire du Département d’État qui a déclaré que Gilbert et le Département d’État avaient des points de vue différents sur la question.
Josh Paul, le directeur qui a démissionné du Département d’État américain en raison de la politique menée à l’égard de Gaza, a également fait une déclaration sur son compte LinkedIn à propos de la démission de Stacy Gilbert.
« La démission de Stacy du PRM souligne l’échec absolu de l’administration Biden et du département d’État de (Antony) Blinken à faire quoi que ce soit – pendant plus de 7 mois de massacre à Gaza, les États-Unis n’ont pas fourni de protection – ils ont fourni des armes ; ils n’ont pas allégé les souffrances – ils ont favorisé une famine ; ils n’ont pas résolu la situation critique des personnes persécutées et déplacées de force en Palestine – ils ont fourni une couverture diplomatique à Israël pour qu’il continue à les persécuter et à les déplacer de force à plusieurs reprises au mépris de toute responsabilité ou justice », a déclaré Paul, qui a supervisé les transferts d’armes américaines lorsqu’il travaillait au département d’État.
** Démission de responsables américains en raison de la politique de Biden à l’égard de Gaza
Lily Greenberg Call, assistante spéciale du chef de cabinet du Département américain de l’intérieur, a annoncé le 16 mai qu’elle démissionnait de son poste en raison du soutien apporté par l’administration Biden aux attaques israéliennes contre Gaza.
Call, diplomate d’origine juive nommé par Biden, a déclaré avoir rejoint l’administration Biden pour « une meilleure Amérique » et a déclaré : « Je ne peux plus, en toute conscience, continuer à représenter cette administration ».
Le major Harrison Mann, en poste à la Defense Intelligence Agency (DIA), organe du Département américain de la défense, a annoncé le 13 mai qu’il démissionnait de son poste en raison du soutien « inconditionnel » de son pays aux attaques israéliennes à Gaza, et que la politique américaine à l’égard de Gaza avait conduit à la mort de « dizaines de milliers de Palestiniens innocents ».
Se référant au fait qu’il a servi dans l’armée américaine pendant 13 ans et qu’il est issu d’une famille d’origine juive européenne, Mann a déclaré : « À un moment donné, quelle que soit la justification, soit vous défendez une politique qui permet d’affamer massivement des enfants, soit vous ne le faites pas ».
Aaron Bushnell, 25 ans, officier de l’armée de l’air américaine, s’est versé de l’essence sur la tête et s’est immolé par le feu devant l’ambassade d’Israël à Washington le 24 février, après avoir déclaré qu’il ne pouvait « plus être complice d’un génocide ».
Annelle Sheline, responsable des relations extérieures, qui avait un contrat de deux ans au Département d’État, a également annoncé publiquement sa démission.
L’exemple de Josh Paul et ses motivations
En octobre, Josh Paul, un haut fonctionnaire du Département d’État américain, a pris la décision de démissionner, marquant une étape significative dans les réactions internes au sein du gouvernement américain face à la guerre à Gaza. Paul, qui occupait un poste clé au sein de l’agence chargée de la gestion des transferts d’armes et des ventes militaires à l’étranger, a choisi de quitter son poste pour manifester son désaccord avec le soutien de l’administration Biden à la guerre menée par Israël à Gaza.
Paul a exprimé ses préoccupations dans une lettre de démission, soulignant les aspects éthiques et moraux de la politique américaine dans le conflit israélo-palestinien. Il a spécifiquement critiqué ce qu’il a décrit comme un “soutien aveugle” à Israël, sans suffisamment prendre en compte les conséquences humanitaires sur la population civile palestinienne.
Sa démission a eu des répercussions immédiates au sein du Département d’État et a suscité un débat intense sur les réseaux sociaux et dans les médias. Des collègues de Paul ont exprimé des sentiments partagés, allant du respect pour sa prise de position courageuse à la critique de son départ en pleine crise. La décision de Paul a également attiré l’attention du public américain, amplifiant les discussions sur la politique étrangère des États-Unis et leur rôle dans les conflits internationaux.
Le départ de Josh Paul a mis en lumière les tensions internes au sein du gouvernement américain concernant la gestion du conflit à Gaza. Il a également révélé un malaise croissant parmi certains fonctionnaires qui estiment que les actions de l’administration Biden ne sont pas en adéquation avec les valeurs humanitaires et démocratiques que les États-Unis prétendent défendre. En démissionnant, Paul a non seulement exprimé sa propre opposition mais a également encouragé un dialogue plus large sur la nécessité de réévaluer la politique extérieure américaine en matière de conflits internationaux.
Les autres démissions et leur impact
La démission de Josh Paul, ancien directeur du Bureau des affaires politico-militaires, n’est pas un phénomène isolé dans la sphère gouvernementale américaine. Depuis le début du conflit à Gaza, plusieurs hauts fonctionnaires ont choisi de quitter leur poste, invoquant des raisons personnelles et professionnelles liées à la politique des États-Unis dans cette région. Parmi eux, on retrouve Samantha Power, administratrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), qui a exprimé des préoccupations similaires concernant l’orientation de la politique étrangère américaine.
En outre, Richard Nephew, coordinateur adjoint pour la politique de sanctions au Département d’État, a également démissionné, citant des divergences sur la stratégie américaine en réponse à la situation à Gaza. Ces démissions sont souvent justifiées par un désaccord profond avec les décisions politiques prises au plus haut niveau, et reflètent un malaise croissant au sein des cercles gouvernementaux face à la gestion du conflit israélo-palestinien.
L’impact cumulé de ces départs est significatif. Tout d’abord, ils affaiblissent temporairement les capacités opérationnelles des agences concernées, nécessitant une réorganisation interne et la nomination de remplaçants compétents. De plus, ces démissions ont alimenté le débat public, suscitant des discussions intenses dans les médias et parmi les différentes factions politiques. Les critiques de la politique étrangère actuelle y voient une preuve supplémentaire de la nécessité de réévaluer la position des États-Unis dans le conflit, tandis que les partisans de l’administration en place tentent de minimiser l’impact de ces départs.
La couverture médiatique de ces démissions a été exhaustive, avec des analyses variées sur les motivations des démissionnaires et les implications pour la politique étrangère américaine. Les médias ont souligné les tensions internes au sein du gouvernement et l’importance de trouver un consensus sur les actions à mener. Les réactions politiques, quant à elles, varient de l’appel à une révision complète de la stratégie à des propositions pour renforcer le soutien aux alliés traditionnels des États-Unis.
En fin de compte, ces départs pourraient influencer de manière significative la politique étrangère des États-Unis, en incitant à un réexamen des priorités et des alliances dans une région en crise. Les démissions de ces fonctionnaires américains sont un signal fort d’un besoin de dialogue et de réflexion approfondie sur l’engagement des États-Unis à l’échelle internationale.
Le bombardement du camp de déplacés à Rafah par l’armée israélienne s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre Israël et Gaza.
Le bombardement des hôpitaux de Gaza : un crime contre l’humanité
Contexte et Détails du Bombardement
Le bombardement du camp de déplacés à Rafah par l’armée israélienne s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre Israël et Gaza. Depuis plusieurs mois, la région connaît une escalade des violences, marquée par des échanges de tirs de roquettes et des frappes aériennes. Cette attaque ciblée, ayant causé plusieurs dizaines de morts, a été justifiée par Israël comme une réponse à des menaces sécuritaires imminentes provenant de groupes militants actifs à Gaza.
Le contexte politique actuel est dominé par un climat de méfiance et de confrontation. Les autorités israéliennes déclarent que des opérations militaires comme celle de Rafah sont nécessaires pour protéger leur population contre les attaques. Néanmoins, ces actions militaires entraînent souvent des pertes civiles significatives, ce qui suscite une vive indignation internationale et des appels à la retenue. Les bombardements de Rafah ont été particulièrement dévastateurs, touchant un camp de déplacés où de nombreuses familles avaient trouvé refuge, loin des zones de combats.
Les premiers témoignages des survivants décrivent une scène de chaos et de destruction. Des familles entières ont été ensevelies sous les décombres, et les premiers secours ont eu des difficultés à accéder aux victimes en raison des dégâts considérables. Les bilans préliminaires font état de dizaines de morts et de nombreux blessés, y compris des femmes et des enfants. Ces récits poignants ont rapidement attiré l’attention des médias internationaux, alimentant les critiques à l’encontre des méthodes employées par l’armée israélienne.
Cette attaque s’inscrit dans une série d’opérations militaires menées par Israël dans la région, souvent justifiées par la nécessité de neutraliser des menaces potentielles. Cependant, chaque nouvelle opération intensifie les tensions et rend plus difficile la recherche d’une solution pacifique au conflit. La communauté internationale reste divisée sur la manière d’aborder cette situation complexe, oscillant entre le soutien aux mesures de sécurité d’Israël et la condamnation des pertes civiles évitables. Le bombardement de Rafah est ainsi devenu un symbole des défis persistants dans la quête de paix et de stabilité au Moyen-Orient.
Réactions Internationales et Implications Juridiques
La communauté internationale a réagi avec une indignation généralisée à l’attaque sur Rafah, qualifiée de “massacre abominable” par diverses organisations et gouvernements. Les Nations Unies, l’Union Européenne, et plusieurs pays, y compris des alliés traditionnels d’Israël, ont exprimé des critiques sévères et ont demandé des enquêtes indépendantes. La Cour Internationale de Justice (CIJ) a joué un rôle crucial en émettant une injonction ordonnant à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires à Rafah.
La réponse d’Israël à cette injonction a été perçue comme un acte de défi envers le droit international. Le gouvernement israélien a non seulement rejeté l’injonction, mais a également intensifié ses opérations militaires, invoquant des raisons de sécurité nationale. Cet acte de défi a suscité des débats intenses au sein des forums internationaux sur le respect des normes juridiques et des résolutions internationales.
Les implications juridiques pour Israël sont potentiellement significatives. La CIJ et d’autres tribunaux internationaux pourraient envisager des sanctions, voire des accusations de crimes de guerre. Plusieurs pays et organisations non gouvernementales ont déjà commencé à documenter des preuves en vue de futures poursuites. Les prises de position des différents pays varient, mais une tendance générale de condamnation et de demande de justice prévaut.
Les perspectives pour la résolution de ce conflit restent incertaines. Alors que certaines nations appellent à des négociations et à des solutions diplomatiques, d’autres prônent des sanctions plus strictes contre Israël. Les organisations internationales, telles que les Nations Unies, continuent de jouer un rôle de médiateur, bien que leur efficacité soit souvent remise en question. L’avenir de la situation à Rafah dépend largement des développements juridiques et des pressions internationales pour un respect accru du droit international et des droits humains.




En savoir plus sur RT en français: https://francais.rt.com/international/111064-nations-unies-assemblee-generale-prononce-adhesion-palestine


The horrifying reality of what it means:
•34,454 murdered
•14,778 children murdered
•30 children from starvation
•6 mass graves in hospitals, victims torture & executed
Netanyahu is a monster.
Where is The Hague?
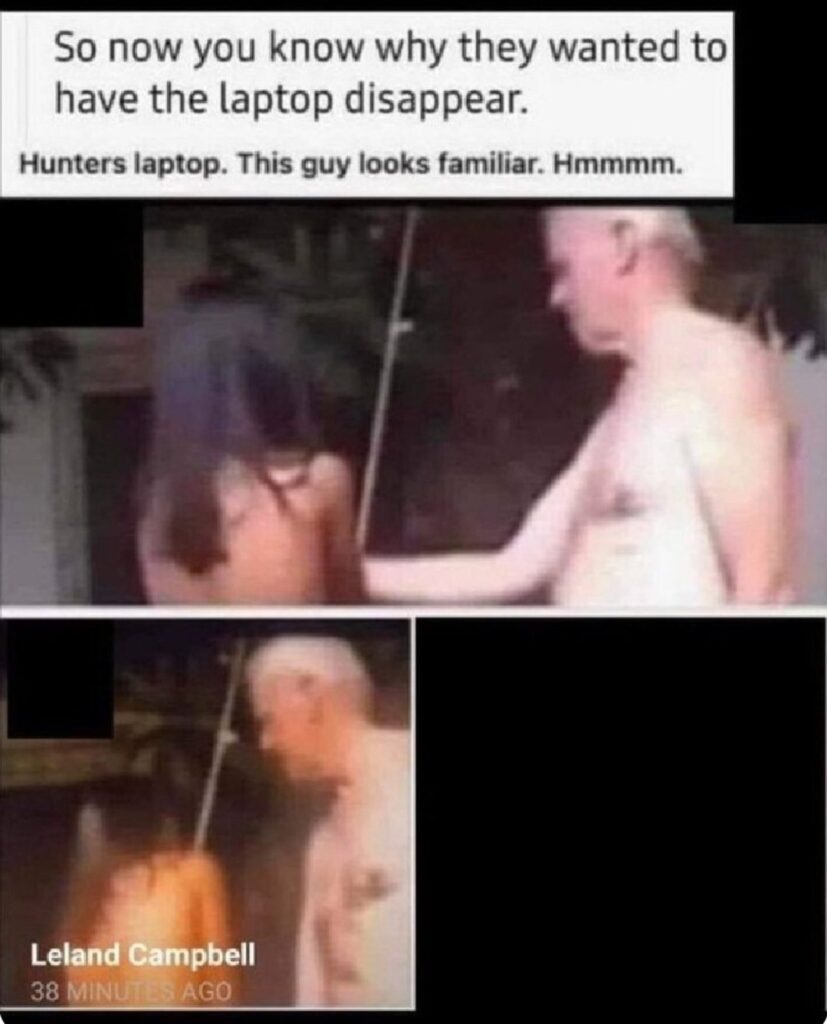

Don’t you love the diversity?

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas répondu aux questions sur son état de santé, affirmant seulement qu’il n’y avait « aucune inquiétude » malgré des bandages et des contusions visibles.









