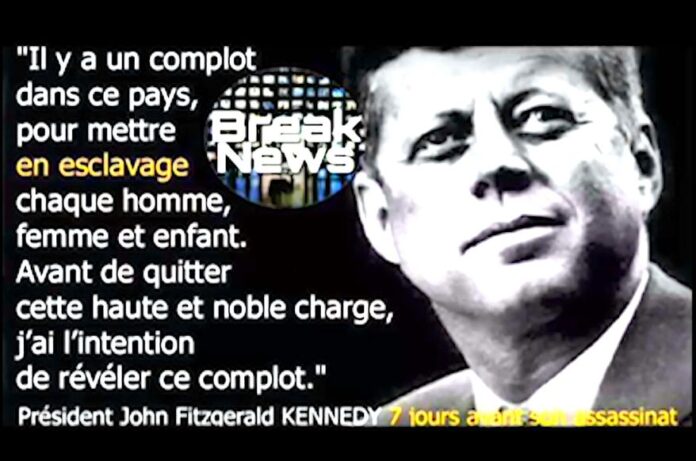Yes. pic.twitter.com/UfU3dZWMLI
— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis__) April 12, 2025
JFK warned that “The very word ‘secrecy’ is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secrecy … We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers… https://t.co/cM0lxiycA7
— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) January 24, 2025
You do know that Israel is funding them, too, right? pic.twitter.com/9bsFM7c3CA
— Mofobian (@Mofobian) February 14, 2025
MOSSAD killed John F Kennedy because they were furious JFK made Ben-Gurion the first PM and founder of Israel resign due to nuclear weapons testing at Dimona…🇺🇸🇮🇱
— Pelham (@Resist_05) February 13, 2025
pic.twitter.com/uR9FAa80mD
The one US president who told the truth.
— Use Yandex Search Engine for Anti Zionist searches (@_NicoleNonya) December 31, 2024
JFK stood up to Israel, demanded #AIPAC register as a foreign agent, against censorship, subversion and invasions, thus.. Israel murdered him.
The speech every American should listen to. pic.twitter.com/pyM1QLSVYa
🇺🇸 JFK was assassinated 5 months after he gave this speech…
— Pelham (@Resist_05) September 6, 2024
Declassified documents show President John F Kennedy warned Israeli Prime Minister Levi Eshkol in 1963 that U.S. support for the young country would be “seriously jeopardized” if Israel did not allow the United States… pic.twitter.com/wBQ7JBDC06
charset="utf-8">This isn’t Germany 1935
— ADAM (@AdameMedia) February 13, 2025
It’s Israel 2025
lsraeIis run the cоncentration camps now.pic.twitter.com/WuhDfQgJwd
🇾🇪 Yemen is READY! pic.twitter.com/anYVaaowd1
— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 12, 2025
The Terrorist State of Israel couldn't have carried out the Genocide without the support of EU Member States like France – Macron has the blood of Palestinians on his hands… https://t.co/5U8X685Zhb
— Mick Wallace (@wallacemick) April 12, 2025
I find myself increasingly confused by the Zionist lobby’s explicit aims at this point.
— Candace Owens (@RealCandaceO) April 11, 2025
They are losing support faster than they have ever lost it because they lie, misrepresent and smear—yet they persist with this strategy.
At what point does one pivot a losing PR campaign?
WTF is this? pic.twitter.com/uNkGrKmNVV
— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis__) April 11, 2025
Qui a tué le Président John F. Kennedy? Vous nous croiriez si nous vous le disions.
Un nouveau Gallup sondage montre que 65 pour cent des Américains croient maintenant JFK a été tué le 22 Novembre 1963, à la suite d’une conspiration d’assassinat, rejetant la théorie officielle “Lone Gunman” que le 1964 Rapport de la Commission President’s sur l’assassinat du Président John F. Kennedy, a.k.a.le rapport de la Commission Warren, proposé.
Comme Biographie précédemment observé:
“Peu d’événements historiques ont donné lieu à des centaines, peut-être même des milliers de théories du complot comme l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963 à Dallas. D’un travail intérieur à un homme parapluie non identifié, des extraterrestres, plusieurs hommes armés et un effort conjoint entre les Cubains et les Soviétiques ont tous été considérés comme l’auteur de la disparition de Kennedy’s ou directement impliqué dans celle-ci.”
Il y a 60 ans que ce jour fatidique au centre-ville de Dallas, quand Lee Harvey Oswald, perché derrière une fenêtre à l’étage du bâtiment Texas School Book Depository, aurait tiré sur Kennedy’s Lincoln Continental convertible alors que le président traversait des foules encourageantes, le frappant deux fois. Aujourd’hui, beaucoup sont encore à la recherche d’une réponse satisfaisante à qui vraiment jfk tué, saisissant pour tout ce qui semble l’invocation dans l’espoir que, s’ils tirent assez à elle, tout le mystère se démêler.
Dans le nouveau documentaire Paramount+ JFK: Ce que les Médecins ont vu, we’re traité à a réexamen de la divergence entre les conclusions tirées par les médecins qui ont vu pour la première fois le président Kennedy au Parkland Memorial Hospital (qui croient que le trou dans le cou de Kennedy’s était une plaie d’entrée) et l’autopsie ultérieure (qui a affirmé que le trou du cou était une plaie de sortie), avec des allégations selon lesquelles une influence indue a été exercée sur cette dernière équipe médicale.
Pendant ce temps cinéaste Rob Reiner a lancé une nouvelle série iHeartPodcasts avec le journaliste Soledad O’Brien qui prétend avoir “nouvelle preuve décisive” qui a tué JFK.
Dans les deux cas, ces programmes servent principalement des personnes pour lesquelles l’assassinat de John F. Kennedy et les circonstances qui l’entourent n’étaient pas une redéfinition de sa présidence, mais sans doute son moment décisif.
Le discours du gouvernement conspirations et les succès orchestrés par la mafia ont tellement imprégné la culture populaire (en particulier après la sortie de Oliver Stone’s 1991 film à succès JFK), qu’il ne serait pas injuste de suggérer que la plupart des Américains post-Baby Boomer connaissent la mort de JFK’s bien plus que sa vie.
Soixante-cinq pour cent des Américains ont entendu et croient qu’une conspiration était à l’origine du meurtre de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963. Qu’est-ce que les sondages auraient montré si Gallup avait demandé si les répondants en avaient entendu parler autre événements dans la vie des 35th président des États-Unis?
https://twitter.com/JuanLuisTostad1/status/1847909423349444616

So LBJ had JFK killed?
— Hodgetwins (@hodgetwins) January 15, 2025
Conspiracy theorists right again https://t.co/61Unt9cG52
🚨BREAKING: JFK was killed for trying to expose the corrupt elites. Do you support Donald Trump in his fight to uncover the truth behind it?
— Donald J. Trump Reports (@TrumpRealDaily) January 14, 2025
YES or NO? pic.twitter.com/0Gbh5V0PoC
Thank you, President Trump. As a boy, I sat in the Oval Office where my uncle led on the issues of health and fitness. And now, six decades later, I stand with a transformational leader who fully grasps the public health crisis our great nation faces. I couldn’t be more thrilled… pic.twitter.com/jnuRksNmJ6
— Secretary Kennedy (@SecKennedy) February 14, 2025
I can't tell you how happy this makes me.. Thank you for your service to this country.. this picture is so appropriate now more than ever.. A Kennedy is back 🇺🇸 pic.twitter.com/UbAarP0rZO
— OnePissedOffGirl🇺🇸 (@LgPatriotNY) February 14, 2025
https://twitter.com/FreeThinkerFit/status/1801133894432965099
RFK Jr. dropping red pills about JFK: pic.twitter.com/xHix1DE65o
— Mr Commonsense (@fopminui) January 16, 2025
— QueSaraSara (@que7sara) January 16, 2025
Proof how far the Democrat party has fallen🤦♂️#JoeBidum pic.twitter.com/Ozx1rC9GRc
— Time4SumAxShun (@Time4SumAxShun) January 16, 2025
Contexte historique des relations américano-israéliennes dans les années 1960
Dans les années 1960, les relations entre les États-Unis et Israël se sont considérablement renforcées, marquées par un soutien militaire et économique croissant. Ce rapprochement s’inscrit dans un contexte géopolitique tumultueux. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le nouvel État d’Israël, établi en 1948, a rapidement gagné le soutien des États-Unis, qui voyaient en lui un allié stratégique au Moyen-Orient. Le soutien américain a permis à Israël de surmonter des menaces existentielle provenant des pays voisins hostiles.
La guerre de Suez en 1956, où Israël, conjointement avec la France et le Royaume-Uni, a mené une opération militaire contre l’Égypte, a exacerbé les tensions. Cela a, cependant, eu pour effet de solidifier le soutien américain envers Israël, avec des préoccupations croissantes liées à l’expansion de l’influence soviétique dans la région. Les États-Unis ont alors perçu la nécessité d’avoir un partenaire fiable au Moyen-Orient pour contrer le communisme. Ainsi, les fournitures militaires américaines à Israël ont considérablement augmenté, posant les bases d’une alliance durable.
Au cours de cette période, un enjeu majeur est survenu concernant les ambitions nucléaires d’Israël. Les États-Unis, bien qu’en soutien d’Israël, étaient également préoccupés par la prolifération nucléaire dans la région. Avec le conflit arabo-israélien en toile de fond, Washington a lancé des initiatives pour contrôler l’armement nucléaire au Moyen-Orient. Ces efforts typiquement impliquaient la surveillance des installations nucléaires de pays comme Israël, opposés à des voisins tels que l’Égypte. L’administration de John F. Kennedy, en particulier, s’est engagée à éviter une course aux armements nucléaires qui aurait pu multiplier les risques d’une escalade militaire dans cette zone sensible.
Le programme nucléaire israélien : Origines et développements
Le programme nucléaire israélien trouve ses racines dans l’après-guerre, à une époque où la région était marquée par des tensions politiques significatives et des conflits armés. Israël, fondé en 1948, s’est vu confronté à de nombreuses menaces existentielles, ce qui a incité le pays à rechercher des capacités militaires avancées, y compris des armes nucléaires, pour assurer sa sécurité. La conscience d’une vulnérabilité face à ses voisins arabes a jouent un rôle crucial dans le développement de ce programme.
Au cours des années 1950, Israël a établi des partenariats avec des pays tels que la France, qui a fourni une aide technique et matérielle essentielle. Le traité de coopération nucléaire signé avec la France en 1957 a permis à Israël de construire son premier réacteur nucléaire à Dimona, une étape clé dans l’aménagement de ses capacités nucléaires. Ce réacteur a été conçu non seulement pour la recherche scientifique, mais également comme un moyen d’acquérir des matières fissiles pour la fabrication d’armes nucléaires, engendrant ainsi des préoccupations tant au niveau régional qu’international.
L’affirmation d’Israël sur la nécessité de développer un programme nucléaire s’appuie sur des motivations stratégiques bien établies, notamment la dissuasion contre des adversaires régionaux perçus comme hostiles. Le principe de la « défense totale » a été introduit par les dirigeants israéliens, en soulignant l’idée que le pays devait disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir sa survie face aux menaces de destruction. Cela a renforcé la détermination d’Israël à maintenir un secret rigoureux autour de son programme nucléaire.
En somme, les origines et le développement du programme nucléaire israélien se présentent comme un reflet des aspirations de sécurité d’un État confronté à l’incertitude géopolitique, sur fond d’une dynamique internationale complexe liée à la prolifération nucléaire.
L’engagement de John F. Kennedy en matière de non-prolifération nucléaire
John F. Kennedy a joué un rôle central dans la promotion de la non-prolifération nucléaire à travers le monde durant sa présidence. Confronté à la menace croissante de la guerre froide et à la prolifération d’armes nucléaires, il a reconnu la nécessité d’un cadre international solide pour prévenir la diffusion de la technologie atomique. En 1963, Kennedy a encouragé la signature du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui a constitué un tournant majeur dans les efforts mondiaux visant à contrôler la prolifération nucléaire.
Ce traité a permis de créer une distinction claire entre les États dotés d’armes nucléaires et ceux qui ne les possédaient pas. Kennedy a constamment plaidé en faveur de la diplomatie et de la coopération internationale comme moyens de gérer les tensions liées aux armes nucléaires. Sa vision était que la non-prolifération nucléaire ne devait pas seulement être une question militaire, mais un préalable à la paix mondiale. Cette approche a conduit à plusieurs initiatives diplomatiques qui ont tenté de réduire les arsenaux nucléaires, y compris la promotion des inspections et des régimes de vérification.
En parallèle, Kennedy a exprimé des inquiétudes spécifiques à l’égard du programme nucléaire israélien, redoutant qu’il puisse provoquer une escalade des tensions au Moyen-Orient. Ainsi, bien que l’administration Kennedy ait soutenu le droit d’Israël à se défendre, elle était également préoccupée par les implications d’une course à l’armement nucléaire dans la région. Malgré ces préoccupations, Kennedy a tenté d’engager un dialogue constructif avec Israël afin d’encourager le pays à adopter un stance sur la non-prolifération. Ces efforts témoignent de son engagement envers un monde sans armes nucléaires et soulignent les défis complexes liés à la diplomatie nucléaire durant la guerre froide.
Les pressions exercées par Kennedy : Inspections nucléaires en Israël
Au début des années 1960, John F. Kennedy a manifesté un intérêt marqué pour la question des armes nucléaires au Moyen-Orient, en particulier en ce qui concerne le programme nucléaire israélien. À cette époque, les États-Unis étaient confrontés à de multiples défis en matière de sécurité dans la région, notamment les conflits armés et l’ascension du nationalisme arabe. Pour atténuer le risque de prolifération nucléaire, Kennedy a appelé à la mise en place de mécanismes d’inspection des installations nucléaires israéliennes.
Les preuves historiques indiquent que Kennedy était particulièrement préoccupé par l’impact potentiel des projets nucléaires d’Israël sur l’équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. En 1963, il a exprimé son inquiétude à ses conseillers en matière de sécurité nationale concernant l’absence de supervision sur les activités nucléaires d’Israël. Par la suite, il a exhorté le gouvernement israélien à coopérer avec les inspecteurs internationaux pour s’assurer que son programme nucléaire ne soit pas détourné à des fins militaires.
Les documents déclassifiés révèlent que Kennedy a rencontré plusieurs hauts responsables israéliens pour discuter de ces préoccupations. Il a clairement fait entendre que le soutien militaire et diplomatique des États-Unis à Israël dépendrait en partie de la transparence d’Israël en matière nucléaire. Des témoignages de cette époque montrent que Kennedy était prêt à prendre des mesures énergiques pour inciter Israël à accepter des inspections, soulignant son engagement envers un Moyen-Orient sans armes nucléaires.
Ce phénomène a engendré des tensions au sein de l’administration israélienne, qui était en désaccord avec l’idée d’une surveillance internationale de ses installations. Malgré ce climat conflictuel, la position ferme de Kennedyjete ne doit pas être sous-estimée. La crise autour des inspections nucléaires en Israël illustre les défis de la diplomatie dans cette période de guerre froide et souligne l’importance de ces événements dans l’histoire des relations États-Unis-Israël.
La menace de suspension de l’aide américaine : Un tournant dangereux
Dans le contexte des relations américano-israéliennes des années 1960, la menace de John F. Kennedy de suspendre l’aide militaire et financière à Israël représentait un moment clé dans les dynamiques de pouvoir au Moyen-Orient. Cette position, qui a été articulée dans le cadre des inspections des installations nucléaires israéliennes, soulignait l’importance croissante que les États-Unis accordaient à la non-prolifération nucléaire dans la région. Kennedy, percevant le développement d’un potentiel nucléaire israélien comme une menace pour la stabilité régionale, estimait qu’une coopération transparente et des inspections rigoureuses étaient indispensables pour apaiser les inquiétudes tant des Arabes que des autres nations.
La possibilité de suspendre l’aide américaine fut non seulement un avertissement sévère, mais aussi un argument stratégique. En exerçant ce type de pression, Kennedy cherchait à équilibrer les intérêts américains au Moyen-Orient, tout en maintenant la sécurité d’Israël. Cette menace permit de mettre en lumière les divergences qui existaient au sein de l’administration américaine concernant la manière de traiter les ambitions nucléaires d’Israël. D’une part, certains responsables soutenaient les mesures fermes de Kennedy, estimant qu’elles étaient nécessaires pour prévenir la prolifération dans une région déjà instable. D’autre part, un groupe plus favorable à Israël argumentait que de telles menaces pouvaient compromettre une relation déjà fragile et nuire à la confiance entre les alliés.
Les implications de cette menace de suspension de l’aide entraînaient non seulement une attention accrue sur la politique israélienne, mais aussi sur l’avenir des accords bilatéraux. Pour Israël, un pays qui dépendait largement de l’assistance militaire et financière américaine, cette menace était perçue comme un tournant dangereux, susceptible de modifier l’équilibre des pouvoirs dans la région. L’interaction entre Kennedy et le gouvernement israélien durant cette période a révélé la complexité des relations diplomatiques et les conséquences potentielles d’une approche plus ferme envers les ambitions nucléaires israéliennes, marquant ainsi une étape décisive dans l’évolution de la politique américaine au Moyen-Orient.
La réaction d’Israël : Réponse aux pressions de Kennedy
Face aux pressions exercées par l’administration Kennedy sur le programme nucléaire israélien, le gouvernement israélien a adopté une approche stratégique qui visait à apaiser les inquiétudes tout en préservant sa souveraineté et la confidentialité de son programme. Israël a compris que les États-Unis, sous Kennedy, avaient des préoccupations légitimes concernant la prolifération nucléaire, particulièrement dans un contexte où la guerre froide influençait l’instabilité au Moyen-Orient. Ainsi, la réponse d’Israël était à la fois diplomatique et stratégique.
Pour répondre aux demandes de transparence concernant ses capacités nucléaires, Israël a choisi de jouer sur la ambiguïté stratégique, un concept qui consiste à ne ni confirmer ni démentir l’existence d’un programme nucléaire militarisé. Cette tactique visait à dissuader des adversaires tout en évitant de provoquer des inquiétudes supplémentaires auprès des alliés occidentaux. Israël espérait que, par cette approche, ils pourraient maintenir leur programme en toute sécurité tout en évitant une escalade des tensions avec Washington.
Parallèlement, le gouvernement israélien a cherché à renforcer ses relations avec d’autres puissances, notamment la France, qui était alors un partenaire clé dans le développement de capacités nucléaires. Cette alliance a permis à Israël de contourner certaines des inquiétudes américaines en montrant qu’elle entretenait des relations diplomatiques solides avec d’autres nations, ce qui pouvait servir ses intérêts stratégiques regionaux.
Toutefois, cette posture a également été renforcée par des convictions profondes au sein du leadership israélien, qui considérait la capacité nucléaire comme essentielle à sa survie face à des voisins hostiles. En effet, la sécurité nationale était la priorité absolue, justifiant ainsi le maintien du secret sur le programme nucléaire et le rejet des pressions extérieures. Cette réponse d’Israël face à Kennedy illustre bien l’équilibre délicat que l’État hébreu a dû naviguer entre ses propres objectifs de sécurité et les attentes de ses partenaires occidentaux.
Le climat politique en 1963 : Les tensions croissantes
En 1963, le climat politique était marqué par des tensions tant sur le plan national qu’international. Aux États-Unis, la présidence de John F. Kennedy était confrontée à de nombreux défis internes, y compris la lutte pour les droits civiques et la guerre froide. La population américaine était divisée sur des questions telles que l’intégration raciale et l’implication militaire dans des conflits étrangers. Ces tensions internes ont souvent compliqué la prise de décision et l’orientation de la politique étrangère du pays.
Par ailleurs, Israël, qui venait d’établir son État en 1948, se retrouvait confronté à des menaces sécuritaires régionales. Les tensions avec les pays voisins, notamment l’Égypte et la Syrie, étaient palpables. La perception qu’Israël était entouré d’ennemis hostiles a renforcé le besoin impératif d’une défense robuste et d’une stratégie de survie. Ces préoccupations sécuritaires ont joué un rôle déterminant dans la politique israélienne, influençant ses relations avec les États-Unis et les autres puissances mondiales.
Dans ce contexte, la coopération entre les États-Unis et Israël s’est intensifiée. Les deux nations ont commencé à échanger des informations et des ressources, notamment en matière de technologie militaire. Kennedy, conscient du besoin d’Israël d’assurer sa sécurité dans un environnement instable, a cherché à établir un équilibre entre le soutien à son allié et la nécessité de gérer les tensions avec d’autres pays du Moyen-Orient.
Cependant, cette dynamique était également marquée par des préoccupations croissantes concernant la course aux armements au Moyen-Orient. Les développements militaires chez les nations arabes, couplés aux ambitions nucléaires d’Israël, ont fait craindre une escalade potentiellement dévastatrice. Ce climat de tensions a ainsi contribué à façonner une politique étrangère complexe pour les États-Unis, qui devait naviguer entre le soutien à la sécurité d’Israël et la stabilité régionale.
L’assassinat de Kennedy : Impact sur la politique nucléaire
L’assassinat du président John F. Kennedy en novembre 1963 a laissé une empreinte indélébile sur la politique étrangère américaine, notamment en ce qui concerne les inspections nucléaires en Israël. Avant sa mort, Kennedy avait adopté une approche prudente envers le programme nucléaire israélien, cherchant à établir un système de vérification par le biais d’inspections. Sa vision incluait non seulement l’empêchement de la prolifération nucléaire, mais également le renforcement de la sécurité régionale au Moyen-Orient, en favorisant des accords de transparence qui auraient pu réduire les tensions entre Israël et ses voisins.
Cependant, l’assassinat de Kennedy a conduit à un changement dramatique dans la politique américaine. Les successeurs, à commencer par Lyndon B. Johnson, ont plutôt mis l’accent sur des priorités différentes, se concentrant davantage sur l’escalade de l’engagement militaire au Vietnam et sur des politiques qui ne favorisaient pas les inspections rigoureuses du programme nucléaire israélien. Sous Johnson, les États-Unis ont adopté une approche plus complaisante, adoptant un statut quo qui a facilité l’expansion du programme nucléaire israélien sans un examen significatif de ses implications. Ce changement a contribué à créer une dynamique où les préoccupations liées à la prolifération nucléaire ont été souvent mises de côté, influençant négativement les relations entre les États-Unis et d’autres puissances du Moyen-Orient.
À long terme, cette nouvelle orientation a eu pour effet de banalisiser le programme d’armement nucléaire israélien, minimisant la nécessité des inspections. Les gouvernements suivants sont restés en grande partie silencieux sur cette question, craignant que des critiques à l’égard d’Israël n’affaiblissent les relations stratégiques essentielles dans la région. Ainsi, l’assassinat de Kennedy a eu des répercussions qui ont façonné la politique étrangère américaine pendant plusieurs décennies, en réduisant l’accent sur le contrôle des armements et en normalisant la dynamique nucléaire en Israël.
Héritage et leçons : Les enjeux nucléaires en Méditerranée
L’héritage des actions de John F. Kennedy en matière de politique nucléaire au Moyen-Orient demeure un sujet crucial pour comprendre les dynamiques contemporaines de sécurité internationale. La gestion des activités nucléaires en Israël, notamment, a révélé des défis significatifs en matière de diplomatie et de stratégie militaire. Kennedy, conscient des tensions croissantes dans la région, a mis en place des inspections nucléaires qui visaient à prévenir la prolifération et à stabiliser l’équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Cet engagement a marqué une étape clé dans l’approche américaine de non-prolifération.
Les leçons tirées de l’époque de Kennedy sont toujours d’actualité et soulèvent des questions pressing concernant les politiques américaines contemporaines. L’Iran, par exemple, représente un défi similaire en matière de contrôle nucléaire, un enjeu qui préoccupe les États-Unis et leurs alliés. La stratégie de Kennedy souligne l’importance d’une coopération internationale proactive pour éviter une course à l’armement, un principe qui devrait toujours sous-tendre les relations américaines avec les puissances nucléaires de la région. La mise en place de régimes de vérification rigoureux et d’inspections peut s’avérer essentielle pour garantir que les engagements nucléaires soient respectés.
De plus, l’héritage de Kennedy souligne les défis du dialogue diplomatique dans un contexte où les perceptions de sécurité nationale varient. Les tensions persistantes entre Israël et ses voisins, conjuguées aux ambitions nucléaires d’autres États, nécessitent une approche nuancée et contextuelle. La politique américaine doit évoluer pour prendre en compte les spécificités locales tout en préservant les idéaux de non-prolifération. En conclusion, l’approche de Kennedy face aux défis nucléaires en Méditerranée offre des perspectives précieuses pour les décideurs actuels et futurs, tout en soulignant l’importance d’une vigilance constante dans la sauvegarde de la sécurité internationale.
Coïncidence intéressante, l’un des conseillers de JFK qui l’a averti de ne pas aller à l’encontre d’Israël, pour ne pas exiger qu’Israël se conforme aux traités nucléaires était Samuel Pisar, qui était le Mossad et aussi le beau-père de Sos Anthony Blinken – # Butcherlinken celui maintenant maintenant Exécuter complètement le génocide
An excellent question which was repeated 3 times to Criminal #ButcherBlinken:
— Alpha100 (@100_alpha) January 17, 2025
Why aren't you in the #Hague?
Why aren't you in the #Hague?
Why aren't you in the #Hague? pic.twitter.com/iZpgpkoTRF
There are two worlds… pic.twitter.com/RZFVJOCrNm
— Noctis Draven (@DravenNoctis) February 13, 2025