Un agent du FBI lance l’alerte : un « ordre de ne pas intervenir » a été donné le matin où Charlie Kirk a été assassiné La version officielle s’effondre. Un membre du FBI a lancé l’alerte, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début : les forces de l’ordre locales ont reçu l’ordre de ne pas intervenir quelques instants avant l’assassinat de Charlie Kirk, laissant ainsi aux assassins le champ libre pour passer à l’action et s’enfuir. Ce n’était pas le chaos. C’était une mise en scène. Un coup monté préparé depuis des années.
Tucker Carlson : « Bibi (Netanyahu) parcourt le Moyen-Orient et son propre pays pour dire aux gens sans détour, en affirmant simplement : « Je contrôle les États-Unis. Je contrôle Donald Trump. »
What is up with all the hand signals, first Charlie Kirks security guards now this cop… pic.twitter.com/1EwExScqlN
— Diego (@jcpstudio) October 2, 2025
Here’s the full clip: https://t.co/JwFC5aGWpU
— ĐⱤØ₲Ø🇺🇸 (@KAGdrogo) October 7, 2025
CANDACE OWENS : « LE MÉDECIN LÉGISTE ÉTAIT TOUT NOUVEAU »… TOUT COMME LE CHIRURGIEN Candace révèle que toutes les personnes impliquées dans l’affaire Charlie Kirk étaient nouvelles. • Un nouveau directeur du FBI et de nouveaux membres du FBI dans l’Utah après un « nettoyage ». • Un nouveau PDG et un nouveau chirurgien en chef à l’hôpital, classé extrêmement bas dans le traitement des blessures traumatiques au cou, et qui n’était même pas l’hôpital le plus proche de l’UVU. • Un nouveau juge, nommé en mai 2025 par le gouverneur Cox. • Et le médecin légiste ? « TOUT. TOUT NOUVEAU. » Candace : « Le 10 septembre était le premier jour de travail de tout le monde. » Un tout nouveau chirurgien à l’avant-plan. Un tout nouveau médecin légiste à l’arrière-plan. Que des nouveaux visages. Que des postes clés. Quand TOUS les acteurs clés sont nouveaux, est-ce vraiment une coïncidence ou un complot pour commettre un assassinat ?
🚨 CANDACE OWENS: “THE CORONER WAS BRAND SPANKING NEW”… AND SO WAS THE SURGEON 🚨
— HustleBitch (@HustleBitch_) October 1, 2025
Candace reveals everyone connected to Charlie Kirk’s case was new.
• A new FBI director and new FBI members in Utah after “cleaning house.”
• A new CEO and a new lead surgeon at the hospital,… pic.twitter.com/bepRe6rufK
The modified lapel mic that struck Charlie Kirk’s neck being discreetly handed off and removed from the crime scene pic.twitter.com/BWhozLe9GP
— Irlandarra (@aldamu_jo) September 26, 2025
It's strange that a criminal Prime Minister wanted by the ICC Benjamin Netayaoun and the PEDOCRIMINAL Donald Trump who are bombing seven countries on the other side of the world tweeted about Charlie Kirk a few minutes after his assassination. pic.twitter.com/CTZlmzgZlT
— mfvnnews (@mfvnnews) September 27, 2025
It’s time for Bibi to go. pic.twitter.com/0iNF9zAZfE
— Tucker Carlson Network (@TCNetwork) September 27, 2025
Everything happened after this interview with Charlie Kirk, and when you listen to what she said, there is only one conclusion that comes out. pic.twitter.com/bjrDk8K82U
— KaNKa (@ReiS_TuRCo) September 28, 2025
That’s weird… I don’t see that in this video. I’ll have to go back and see original.. but one of these seems to be altered. Unless my eyes are playing tricks on me.. does anyone else see it? https://t.co/EEel0GzFFU
— Gsteel (@Gsteel2020) September 29, 2025
This is the man that funds Laura Loomer, btw.
— Candace Owens (@RealCandaceO) October 1, 2025
Keep in mind that Laura was attacking Charlie just before he died, and she now demands we stop investigating Charlie’s murder.
Who is directing her to do that? https://t.co/DafbpjNEQI
🚨 CANDACE OWENS: “THE CORONER WAS BRAND SPANKING NEW”… AND SO WAS THE SURGEON 🚨
— HustleBitch (@HustleBitch_) October 1, 2025
Candace reveals everyone connected to Charlie Kirk’s case was new.
• A new FBI director and new FBI members in Utah after “cleaning house.”
• A new CEO and a new lead surgeon at the hospital,… pic.twitter.com/bepRe6rufK
Netanyahu Had Foreknowledge of Charlie Kirk Assassination: 'Lapel Mics Hacked To Explode'
— TPV Sean (@tpvsean) September 30, 2025
Benjamin Netanyahu didn't just predict 9/11 – he mapped it out in detail five years before it happened. And now, the same chilling pattern emerges with the Charlie Kirk assassination.… pic.twitter.com/7RhbBgFLyZ
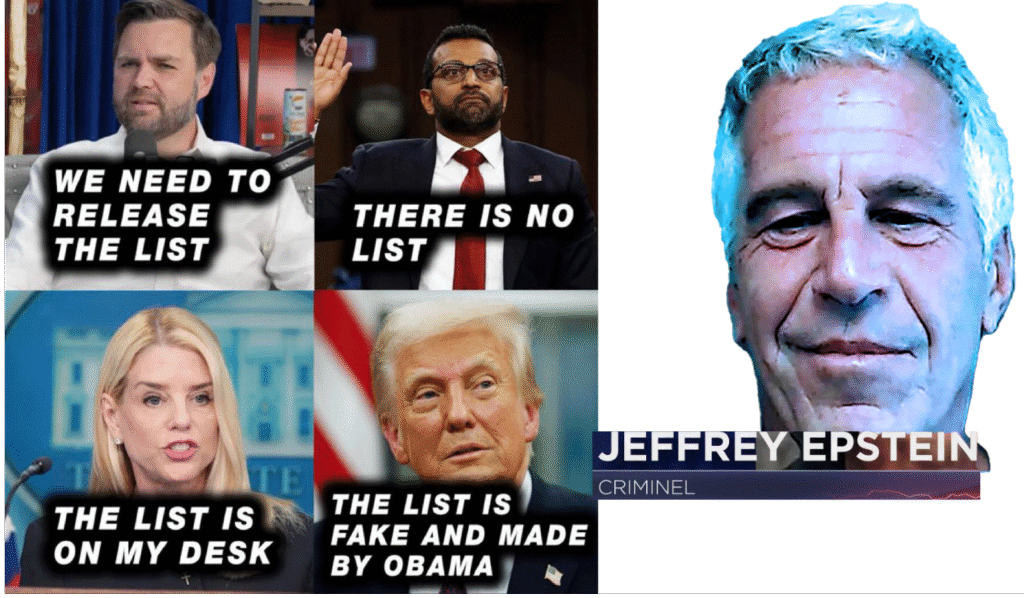
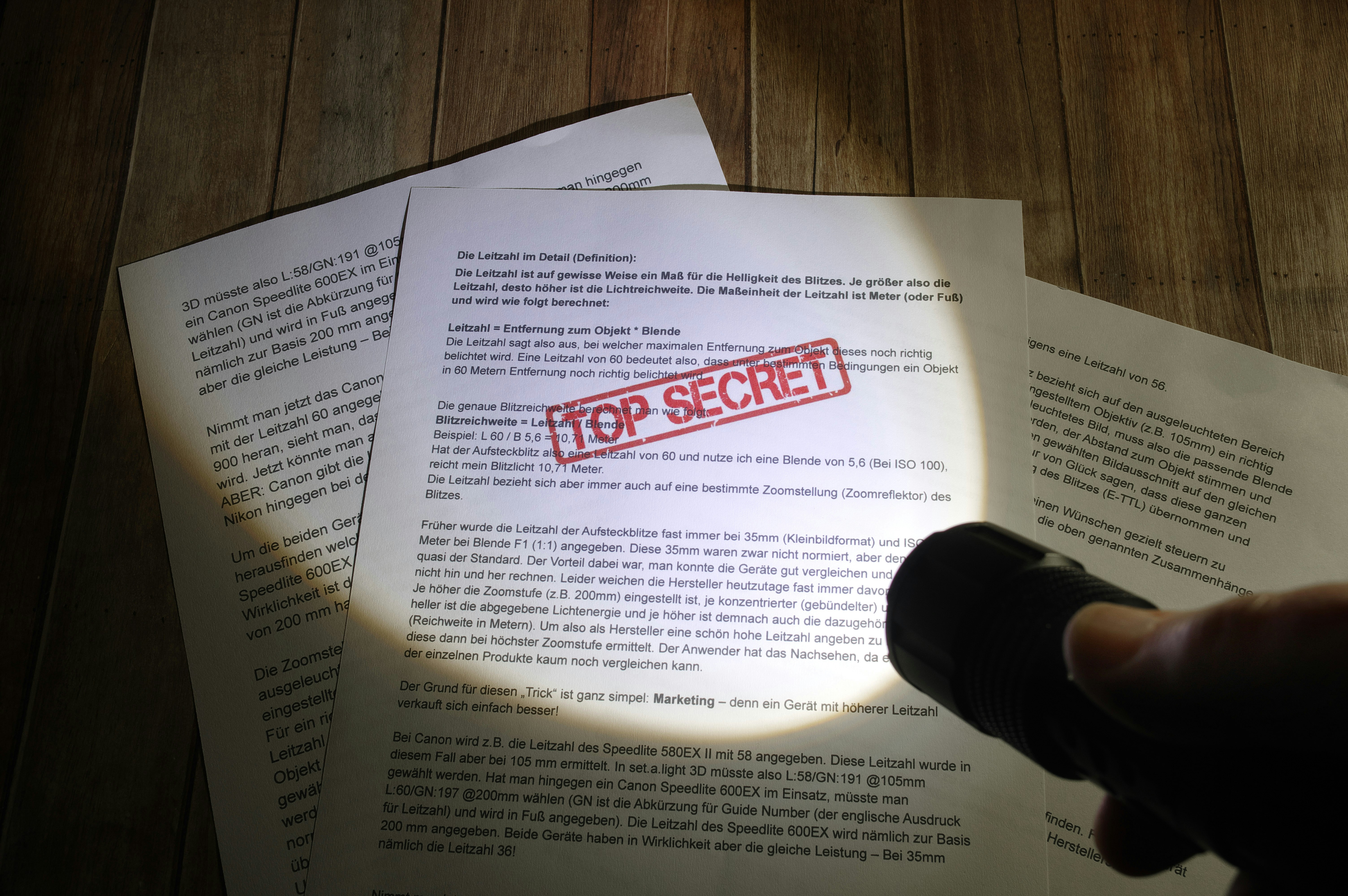
Introduction à l’assassinat de Charlie Kirk
Charlie Kirk, une figure marquante de la politique américaine, est connu pour son engagement dynamique en faveur des principes conservateurs et de sa capacité à mobiliser les jeunes. En tant que fondateur de Turning Point USA, une organisation qui promeut les valeurs conservatrices sur les campus universitaires, il a suscité à la fois admiration et controverse au sein du paysage politique. Son assassinat a non seulement choqué la communauté conservatrice mais a également suscité une onde de choc à travers les États-Unis, attirant l’attention des médias et du public sur les implications plus larges de cet événement tragique.
Le meurtre de Charlie Kirk a été perçu comme un incident révélateur de la polarisation croissante de la société américaine. Les circonstances entourant son assassinat ont conduit à un flot de questions, tant sur la motivation du crime que sur son impact potentiel sur le discours politique. Les spéculations ont rapidement fusé, alimentées par sa stature et l’animus qu’il inspirait dans certains cercles. La réaction immédiate à cette tragédie s’est manifestée par des manifestations, des veillées et des appels à la justice, alors que ses partisans et adversaires réfléchissaient à la portée de cet acte violent.
La couverture médiatique a joué un rôle crucial dans la formation de l’opinion publique sur l’assassinat de Kirk. Les récits, souvent sensationnalistes, ont varié, certains mettant en avant les implications politiques de sa mort tandis que d’autres soulignaient la nécessité d’un dialogue sur la violence politique. Dans ce contexte, comprendre l’homme derrière le nom, son influence sur les jeunes générations, et la réaction face à cet acte devient essentiel pour juger de l’impact global sur la société américaine. Le récit officiel, en particulier celui proposé par le FBI, soulève des questions importantes qui méritent d’être explorées dans les sections ultérieures de ce blog post.
Le récit officiel du FBI : Une histoire troublante
Le récit officiel du FBI concernant l’assassinat de Charlie Kirk présente une série de détails intrigants qui soulèvent des questions sur la véracité de cette version des faits. Selon les rapports, le FBI a déclaré que l’assassinat était le résultat d’une conspiration orchestrée par un petit groupe ayant des motifs politiques. Cependant, plusieurs éléments de cette narration semblent peu convaincants et méritent une analyse approfondie.
Tout d’abord, le timing des déclarations du FBI est troublant. Les autorités ont rapidement attribué la responsabilité de cet acte violent à une organisation, mais les preuves fournies manquent de clarté. Les témoignages recueillis semblent souvent contradictoires, et les éléments matériels n’ont pas été divulgués de manière transparente. Ce manque de transparence alimente les spéculations sur la véritable nature des événements et sur l’existence d’éventuels dissimulations.
Ensuite, la présentation de Charlie Kirk lui-même dans le récit du FBI soulève des questions. Bien que le rapport mentionne ses prises de position politiques clairsemées, la complexité de sa personnalité et les nuances de ses engagements semblent simplifiées. Une telle simplification peut déformer la compréhension des raisons qui auraient pu mener à son assassinat. De nombreux observateurs notent que cette approche réductrice peut potentiellement omettre des aspects cruciaux de sa vie qui pourraient éclairer les véritables motivations derrière le crime.
Enfin, la réaction du FBI à la pression médiatique et publique pour élaborer une explication rapide témoigne d’une potentielle manipulation de l’information. La priorité accordée à la diffusion de cette version officielle semble parfois à l’encontre d’une enquête patiente et rigoureuse. À la lumière de ces incohérences, il est légitime de se demander si la narration adoptée par le FBI constitue l’exposé de la réalité ou si elle sert certains objectifs politiques. Par conséquent, il est impératif d’examiner ces éléments de manière critique afin de cerner l’exactitude des conclusions tirées par l’agence.
Les vidéos en ligne : Une transparence contestée
Dans l’ère numérique actuelle, les vidéos en ligne jouent un rôle crucial dans la compréhension des événements marquants. La fusillade associée à l’assassinat de Charlie Kirk a généré de nombreuses vidéos publiées par des témoins oculaires ainsi que par des amateurs. Ces enregistrements visuels offrent un regard brut et sans filtre sur la scène de l’incident, ce qui a conduit à un débat sur leur authenticité et leur fiabilité. Les vidéos circulant sur les plateformes de médias sociaux montrent divers angles et moments de la fusillade, ce qui permet aux spectateurs de tirer leurs propres conclusions.
Cependant, cette accessibilité à des enregistrements bruts soulève des questions sur la véracité des événements. Certains analystes ont noté que certaines vidéos pourraient avoir été manipulées ou sorties de leur contexte pour servir des narrations spécifiques. Par exemple, des ralentis ou des zooms excessifs peuvent déformer la réalité, créant ainsi une perception erronée de ce qui s’est réellement passé. Il est essentiel d’évaluer ces contenus avec un regard critique afin de dissocier les faits des interprétations biaisées.
De plus, l’impact de ces vidéos majeures sur la perception publique est manifeste. Elles ont le potentiel de contredire le récit officiel proposé par le FBI, en exposant des éléments qui ne correspondent pas aux déclarations des autorités. Cela a conduit à une méfiance croissante envers les sources officielles et à une polarisation des opinions publiques. Alors que certains considèrent ces vidéos comme des preuves essentielles de ce qui s’est réellement produit, d’autres peuvent les voir comme des productions biaisées destinées à déstabiliser l’image des forces de l’ordre.
Il est donc primordial d’analyser ces vidéos avec prudence et d’effectuer une vérification rigoureuse des faits avant d’accepter les informations qu’elles véhiculent. La quête de vérité, dans un contexte où les vérités multiples peuvent coexister, demeure une tâche complexe et controversée.
L’arme utilisée : un micro-cravate modifié
Dans le cadre de l’assassinat de Charlie Kirk, le récit officiel du FBI met en avant l’utilisation d’un micro-cravate modifié comme arme. Cet outil, habituellement associé à la captation sonore, a été détourné de son usage initial pour jouer un rôle crucial dans un meurtre soigneusement planifié. Cela soulève des questions sur les motivations des individus impliqués et les mécanismes techniques qui ont été exploités pour mener à bien cet acte.
Un micro-cravate, de par sa conception discrète et portable, a la capacité de passer inaperçu, ce qui le rend particulièrement attrayant pour ceux cherchant à commettre un acte répréhensible sans éveiller les soupçons. Il est important de comprendre comment un tel appareil, généralement inoffensif, a été modifié pour devenir un instrument de mort. Des rapports suggèrent qu’il pourrait avoir été équipé d’un dispositif de libération similaire à ceux utilisés dans la fabrication de dispositifs explosifs ou chimiques. Les détails techniques de cette modification offrent un aperçu de la sophistication et de la planification qui ont pu accompagner cet acte criminel.
Les implications de l’utilisation d’un micro-cravate modifié vont au-delà des simples considérations techniques. Cela pose également la question de la surveillance et de l’espionnage, des thèmes récurrents dans les discussions autour des enquêtes criminelles modernes. La capacité de transformer un outil de communication en arme laisse entrevoir des possibilités inquiétantes concernant la sécurité personnelle et le respect de la vie privée des individus. Cela ouvre également la porte à de nouvelles théories sur les acteurs impliqués dans cet assaut, suggérant une organisation et une intention derrière l’utilisation d’un tel dispositif. La réflexion sur ces éléments pourrait révéler des dynamiques plus larges au sein des groupes impliqués dans ce crime tragique.
Comparaison avec d’autres attaques : Les bombes de téléavertisseur israéliennes
L’assassinat de Charlie Kirk soulève des questions concernant les méthodes et stratégies utilisées par les agences de sécurité dans le cadre d’opérations délicates. Pour établir un cadre d’analyse, il est utile de se tourner vers des incidents antérieurs, notamment les récentes attaques par bombes de téléavertisseur israéliennes. Ces incidents, qui ont souvent recouru à des technologies avancées et à des tactiques d’infiltration, offrent une perspective éclairante sur comment les opérations sont planifiées et exécutées.
Les bombes de téléavertisseur, qui se sont révélées particulièrement meurtrières, partagent certaines caractéristiques avec l’assassinat de Charlie Kirk. Tout d’abord, les deux scénarios montrent comment des groupes organisés peuvent tirer parti de systèmes de communication sophistiqués pour planifier des attaques terroristes. De plus, tant l’assassinat que les attaques menées par bombes de téléavertisseur témoignent d’une certaine adaptabilité des assaillants face à la surveillance accrue des agences de sécurité. En analysant ces comparaisons, il devient évident que les tactiques évoluent, mais que les objectifs restent similaires : infliger des dommages et créer un climat de peur.
Cependant, des différences notables existent également. Les bombes de téléavertisseur représentent une approche à grande échelle, souvent mise en œuvre pour déstabiliser des zones entières, tandis que l’assassinat de Kirk est un ciblage plus direct, visant un individu spécifique. Cette distinction met en lumière une évolution dans la manière dont les groupes choisissent leurs cibles et leurs méthodes. En somme, ces comparaisons entre l’assassinat de Charlie Kirk et les attaques par bombes de téléavertisseur israéliennes suggèrent des ramifications à la fois sur les stratégies des militants et sur les réponses des agences de sécurité, soulignant l’importance d’une analyse rigoureuse des multiples dimensions de la violence politique et de la terreur.
Le rôle présumé du Mossad : Une théorie du complot ou une réalité ?
Dans les discussions entourant l’assassinat de Charlie Kirk, une des questions fréquemment soulevées concerne le rôle que le Mossad, le service de renseignement israélien, aurait pu jouer dans cet événement tragique. Certains soutiennent que l’implication du Mossad pourrait être une réalité masquer une série de manœuvres complexes dans le cadre d’une géopolitique plus vaste. D’autres, en revanche, estiment qu’il ne s’agit que d’une théorie du complot infondée, alimentée par des spéculations sans véritables preuves tangibles.
Les partisans de la théorie de l’implication du Mossad avancent plusieurs points pour appuyer leur affirmation. Ils soulignent que le Mossad est reconnu pour ses opérations secrètes à l’étranger. Ainsi, la possibilité d’une orchestration soigneusement planifiée d’une opération d’assassinat ne serait pas en dehors de son champ d’action. Certaines rumeurs suggèrent que Kirk, en tant que personnage influent, représentait une menace pour les intérêts israéliens, justifiant ainsi une telle action. De plus, les témoins oculaires et certaines sources anonymes auraient rapporté des comportements suspects de la part d’individus liés à des services de renseignement qui pourraient être associés au Mossad.
En revanche, les sceptiques pointent du doigt le manque de preuves concrètes soutenant ces allégations. Le Mossad, comme beaucoup d’agences de renseignement, opère souvent dans l’ombre, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il doit être impliqué dans des événements spécifiques sans preuves solides. De plus, de nombreuses théories du complot manquent de vérification et peuvent être construits sur des interprétations biaisées d’événements réels. Le danger de telles spéculations réside dans leur capacité à alimenter la désinformation et à à obscurcir la vérité.
En résumé, bien que des questions persistent au sujet du rôle du Mossad dans l’assassinat de Charlie Kirk, il est impératif d’examiner les faits avec rigueur avant de tirer des conclusions hâtives. Le mélange de faits connus et d’hypothèses non vérifiées nécessite une approche prudente et analytique.
Réactions des autorités et des médias
Les événements entourant l’assassinat de Charlie Kirk ont suscité une multitude de réactions, tant de la part des autorités que des médias. L’ampleur de cette tragédie a rapidement attiré l’attention nationale, incitant de nombreux politiciens à prendre position. Les premiers discours politiques se sont concentrés sur la nécessité d’une enquête approfondie et transparente. Certains responsables ont appelé à des réformes pour améliorer les mesures de sécurité, tandis que d’autres ont exprimé des préoccupations concernant la violence politique croissante aux États-Unis.
Les déclarations officielles des agences gouvernementales ont également joué un rôle crucial dans la perception publique de cet incident. Le FBI, en particulier, a été sous les projecteurs pour sa gestion de l’affaire. Des critiques ont émergé quant à la manière dont les informations ont été communiquées, certains accusant l’agence de minimiser certains aspects du crime. Dans un contexte aussi délicat, chaque mot compte et peut influencer les sentiments du public, modifiant ainsi la manière dont la société juge la situation.
La couverture médiatique, de son côté, a été variée, oscillant entre des reportages factuels et des analyses plus sensationnalistes. Certains médias ont choisi de mettre en avant des aspects spécifiques de l’assassinat, dessinant des portraits contradictoires du suspect, ou soulignant l’impact social de la perte de Charlie Kirk. Cette diversité des voix médiatiques fait en sorte que l’opinion publique peut être façonnée de manières très différentes, alimentant des débats sur la violence, la liberté d’expression, et la responsabilité des dirigeants dans la prévention de telles tragédies.
Ainsi, tant les autorités que les médias ont profité de cet événement tragique pour exprimer leurs préoccupations, poser des questions et attirer l’attention sur des sujets pertinents. L’interaction entre leurs discours et les réactions du public continuera de façonner le paysage politique et social autour de l’assassinat de Charlie Kirk.
Impact sur la société et la politique
L’assassinat de Charlie Kirk a suscité des débats passionnés qui continuent d’influencer les dialogues sociaux et politiques aux États-Unis et au-delà. Cet événement tragique a mis en évidence les tensions croissantes autour de la sécurité nationale, de l’espionnage, et des droits civiques, provoquant une réévaluation des politiques gouvernementales liées à la protection des citoyens et la surveillance. Les discussions qui ont émergé de cet incident ont d’ailleurs révélé des fractures profondes au sein de la société américaine, notamment sur des questions relatives à la liberté d’expression et à la traçabilité des informations.
Dans un environnement politique où les conceptions de sécurité et de libertés individuelles continuent d’évoluer, cet assassinat a exacerbé le clivage existant entre ceux qui prônent un renforcement des mesures de sécurité et ceux qui plaident en faveur de la protection des libertés fondamentales. Les mouvements politiques ont été affectés, certains en faveur d’une sécurité accrue, utilisant l’incident pour justifier des politiques de surveillance plus rigoureuses. D’autres groupes, en revanche, se sont mobilisés pour défendre des réformes des lois sur l’espionnage, insistant sur le besoin d’une plus grande transparence et d’une protection des droits individuels.
La polarisation accrue au sein des partis politiques a aussi été une conséquence notoire. Les répercussions de l’assassinat de Charlie Kirk ont entraîné des discussions sur la radicalisation et le rôle des médias dans la formation de l’opinion publique. De nombreuses analyses ont mis en lumière le besoin de réexaminer les discours et l’influence que les plateformes médiatiques peuvent avoir sur les perceptions envers la sécurité et l’espionnage.
En somme, l’impact social et politique de cet événement est profond et s’est traduit par des changements dans les initiatives politiques et des réflexions sur la socialisation, invitant la société à poursuivre un dialogue nécessaire sur ces enjeux contemporains.
Conclusion : vers une réévaluation de la vérité
sur les cartes SD des appareils photo que l’équipe TP Point a immédiatement récupérées. Je suis photographe et cinéaste professionnel depuis plus de 20 ans. L’endroit le plus sûr pour les cartes SD est l’appareil photo. J’enseigne à tous mes stagiaires, assistants, etc. à essayer de garder les cartes mémoire dans l’appareil photo jusqu’à ce qu’ils soient de retour à leur studio, leur ordinateur portable, leur bureau, etc. Les cartes sont dotées d’une technologie très sensible. Il est très facile d’endommager une carte dès qu’on la retire de l’appareil photo. Cela n’a aucun sens de les retirer des appareils photo à cet endroit. L’endroit le plus sûr pour les cartes mémoire est toujours l’appareil photo, jusqu’à ce que vous les transfériez sur votre ordinateur. C’est très louche qu’ils aient retiré ces cartes mémoire immédiatement après l’assassinat.
La tragédie entourant l’assassinat de Charlie Kirk a soulevé d’importantes questions sur la manière dont les récits officiels sont construits et relayés par les institutions. Les analyses critiques ont mis en lumière des incohérences dans les informations fournies par le FBI, incitant à une réflexion plus approfondie sur la nature de la vérité et du mensonge dans des affaires aussi sensibles. En tant que société, il est de notre devoir d’examiner de près les informations qui nous sont présentées, surtout lorsque celles-ci proviennent d’entités réputées pour leur autorité.
Les découvertes récentes suggèrent que la désinformation peut se frayer un chemin dans le discours public, façonnant ainsi nos perceptions à l’égard des événements marquants. Cette situation amène à se demander dans quelle mesure la confiance envers les institutions peut être maintenue lorsque des éléments de vérité sont mis en doute. Cette affaire devrait nous inciter à engager des discussions sur les normes qui régissent la communication des faits et sur le rôle des médias dans la diffusion d’informations véridiques.
En fin de compte, la réévaluation de cette situation n’est pas seulement essentielle pour la mémoire de Charlie Kirk, mais également pour l’avenir de la transparence et de la responsabilité au sein des institutions. Les implications de cet assassinat vont au-delà de l’individu ; elles touchent à l’intégrité de nos systèmes d’information. Il est crucial que chacun d’entre nous prenne conscience de ces enjeux et encourage des dialogues constructifs, afin de renforcer notre résilience contre la désinformation et promouvoir un environnement où la vérité peut émerger et être respectée.
Charlie Kirk a été abattu vers le bas à un angle de 10 à 15 degrés par rapport à l’avant, à un angle de sa gauche dans le cou de son amant tandis que son dos était également incliné sous une forme bossue alors qu’il était assis. L’arrière de son cou était à un angle de 45 degrés. L’angle de contact sur sa colonne vertébrale était de 40 à 30 degrés, ce qui signifie que la force sur sa colonne vertébrale était bien inférieure à la moitié de la force potentielle de la balle, environ 40 à 30 %. À un angle de 90 degrés, la force sera pleine force, à 45 degrés seulement la moitié. Entraînez-vous à 40 degrés ou même moins en utilisant vous-même la trigonométrie.
Sa chemise et son collier ont été tirés vers le haut lorsque la balle a frappé sa colonne vertébrale à cet angle, a brisé la colonne vertébrale et a ricoché ou a glissé le long de sa colonne vertébrale lubrifiée en un arc à l’intérieur du corps. Le Bullet n’est pas sorti. Vous pouvez voir le haut de son torse se soulever avec un renflement, de la taille de votre poing, là où la colonne vertébrale a été cassée, avec une force rapide et forte qui correspondait à la vitesse de la balle à l’impact tandis que le reste de son corps est immobile. Regardez le dos de Charlie de son côté alors que la balle le pique. On dirait que quelque chose l’attrape par la colonne vertébrale et le tire vers le haut. Sa colonne vertébrale brisée ne pouvait pas tenir la partie supérieure de son corps qui s’inclinait vers l’avant et vers sa gauche. J’espère que cela résoudra le mystère.
La chose noire à l’intérieur de sa chemise et à l’extérieur de sa chemise à sa droite est un micro de secours.
Le point principal est que la balle est tombée sur un angle de 10 à 15 degrés selon ce que j’ai découvert sur le web. Si vous regardez les vidéos qui montrent Charlie de son côté, vous verrez qu’il était assis le dos en position bossue. L’angle de son dos était de 45 degrés vers l’avant avec la partie du cou de la colonne vertébrale où la balle a frappé, peut-être même plus à un angle vers l’avant. Cela signifie que l’angle d’impact sur la partie supérieure de la colonne vertébrale était d’environ 40 à 30 degrés. [45 moins 10]
Si la colonne vertébrale avait été touchée directement par l’avant et si la colonne vertébrale n’avait pas été inclinée, elle aurait explosé. Cet angle d’impact était bien inférieur à 45 degrés, ce qui signifie bien moins de la moitié de la force de la balle, je ne parle pas de l’avant de son cou mais de l’angle de la colonne vertébrale à l’arrière du cou et en dessous du point d’entrée avant. Si vous traversez un rocher à un angle sur la rivière, il effleurera l’eau en quelques coups avant de couler, même chose ici.
Aucun des soi-disant experts sur le web ne mentionne ou ne regarde même l’angle de la colonne vertébrale par rapport à la trajectoire de la balle. Parce que je suis ingénieur, j’ai d’abord regardé cela pour déterminer où allait toute l’énergie. J’ai même effleuré des balles sur un barrage au-dessus de l’eau à 100 m de distance. Tout comme je l’ai fait avec un gros plan sur un rocher. Je connais également la répartition des forces lors de la construction d’un pont ou d’une structure en acier. Il fonctionne sur les mêmes principes.






![Le colonel Douglas Macgregor révèle que les États-Unis vont entrer en guerre uniquement pour servir les intérêts de l’État israélien, mais CNN et FOX News ne vous montreront jamais cela. Les politiciens corrompus sont achetés et compromis. « Semer le chaos. Pousser les gens dans la rue. Provoquer des effusions de sang. Appeler cela « protéger la démocratie ». » Le professeur Jeffrey Sachs affirme qu'il s'agit là de la stratégie de changement de régime de la CIA et du Mossad, et que nous assistons à sa mise en œuvre en temps réel [en Iran].](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/Sans-titre-65-218x150.png)
![les médias ont rapporté que Trump était sur le point de déclencher une guerre contre l’Iran. JENNIFER WELCH : Ces deux hommes [Trump et Netanyahu] sont des êtres humains répugnants. Ils devraient tous les deux être en prison. Le fait que cet homme [Netanyahu] puisse venir aux États-Unis sans être arrêté et envoyé à La Haye montre à quel point la politique étrangère américaine est moralement dépravée...](https://mfvnnews.com/wp-content/uploads/2026/01/G9gGFjsXQAAc8np-218x150.jpg)